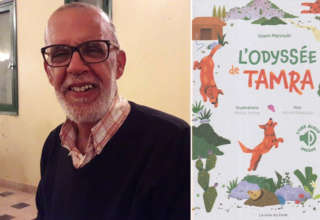Sauveur (Salvatore) Almanza naît à Mateur en Tunisie le 01/01/1931, d’un père originaire de l’île de Pantelleria (Italie) et d’une mère originaire de Camporeale (Palerme), Italie. Ils se sont rencontrés en Tunisie. Le papa, André, était cheminot comme la plupart des Siciliens de Tunisie et il a dû se nationaliser français pour pouvoir garder son travail au sein de la Société des chemins de fer. La mère, Joséphine Rizzuto, sans profession, travaillera comme mère au foyer pour élever ses trois enfants : Laurent, Sauveur et Marinette. Un quatrième enfant, arrivé beaucoup plus tardivement, mourra écrasé par une charrette traversant la rue en face de sa maison à l’âge de 2 ans. Ce drame laissera toute la famille Almanza dans une immense et infinie douleur. Sauveur, étant le deuxième de ces quatre enfants et plus âgé par rapport à Marinette, se souviendra pour toujours de cette douloureuse perte qui ne s’effacera à jamais.
Sauveur nous parle malgré tout d’une enfance heureuse, entouré par une famille nombreuse. Du côté paternel, ils avaient fait fortune aux alentours d’El Fahs. Ses oncles possédaient une ferme, du bétail et à chaque fin de semaine, Sauveur et sa famille s’y rendaient pour passer le dimanche ensemble. Le père de Sauveur n’a jamais fait fortune à cause de sa femme Joséphine, une femme peureuse, analphabète, pieuse et très superstitieuse. Sauveur nous dira, qu’à chaque fois que son père voulait acheter un morceau de terrain ou entreprendre un investissement, sa mère était toujours contre. Son père finira ses jours en France où il sera hospitalisé et enterré au Père Lachaise.
La mère mourra un peu plus tard, aigrie par la douleur et la perte de son petit enfant, et inhumée à Tunis au cimetière chrétien du Borgel.
Sauveur habitera toute son enfance au centre-ville de Tunis, à la rue du Maroc, une rue où des maisonnettes toutes pareilles étaient collées les unes aux autres comme un petit train. En effet il s’agissait des logements des cheminots. Il y avait Josèphe «u muraturi», le maçon, Antoinette dite «a beddra», la plus belle, donna Pippina «a meggera», la mégère , mastru Titta «u piscaturi», le pêcheur, et ainsi de suite… Tous des siciliens. Chacun parle à sa façon et tout le monde se comprend, une sorte de sabir, un mélange de sicilien, d’arabe et de français, le sicilien de Tunisie, l’appellera-t-on plus tard ! Mais collé à la maison de Sauveur il y avait aussi Lydia, sa cousine, très belle fille, grande brune, cheveux très longs, grands yeux pétillants et noirs comme le charbon. Lydia, plus âgée que Sauveur de 10 ans, pratiquait en cachette et chez sa mère le plus vieux métier du monde, racontant à Sauveur toutes ou presque ses aventures et ses rencontres avec des soldats ou des hommes à la recherche d’un amour passager. Mais un jour, un de ses clients, un bel officier français, tomba amoureux de Lydia. Ils se marièrent et partirent en France.
«Figghia disgraziata, m’allibbittai di tia, vattinni vattinni…» (Fille maudite, je me suis enfin débarrassée de toi, va-t’en, va-t’en…), lui cria sa mère en sicilien devant la porte de sa maison , le jour de son départ. Pour Sauveur, ce fut une grande perte, la perte d’une grande amitié mais surtout d’une grande complicité.
Sauveur fréquentera l’école primaire du quartier toujours à la rue du Maroc, une école française située à deux pas de sa maison. Il n’y étudiera que pour trois ans. Sa famille arrive à peine à survivre et donc Sauveur, qui n’était pas du tout un élève brillant, interrompra ses études pour commencer à travailler comme garçon de bar à l’avenue de France. Fatigué et mal payé, il décide à l’âge de 12 ans de quitter ce petit travail et de commencer une sorte de formation (praticantato) chez un sicilien, tailleur pour femme.
Ceci sera le métier officiel de Sauveur qu’il fera jusqu’à l’âge de sa retraite. Il habillera les grandes familles bourgeoises tunisiennes et des riches françaises et italiennes. Même Mme Bourguiba s’habillera de temps en temps chez lui.
Un jour, Sauveur âgé de 20 ans, en train de coudre un habit pour Mme Baldambembo, une très belle femme tunisienne d’origine italienne et de confession juive, vit entrer dans sa boutique un Monsieur très bien habillé, distingué, portant un cylindre sur ta tête.
«C’est vous Sauveur Almamza?» demanda-t-il s’adressant au jeune Sauveur.
«Oui c’est moi Monsieur et vous êtes…?» répliqua-t-il.
«Monsieur Lévy, Moses Lévy»
Sauveur fit tomber par terre les ciseaux qu’il tenait dans ses mains. Il était ému mais en même temps il se demandait le pourquoi de la visite d’un si célèbre artiste peintre. En effet, Moses Lévy montrera trois petits tableaux, huile sur toile à Sauveur lui demandant si ces œuvres étaient bien à lui. Sauveur acquiesça. Il s’agissait vraiment de ses tableaux représentant le premier, des fleurs, le second un portrait et le troisième une nature morte.
Sauveur avait vendu ces trois petits tableaux à un marchand du souk al Attarine qui les avait revendus à Monsieur Lévy qui était tombé sous leur charme. C’est grâce à cette fortuite rencontre que Sauveur Almanza rencontrera plein d’artistes peintres, faisant partie de l’Ecole de Tunis et partagera avec eux des émotions, des espoirs, des joies mais aussi des douleurs. L’Ecole de Tunis est un courant artistique de la peinture tunisienne qui naît après la Seconde Guerre mondiale grâce à quelques peintres tunisiens, français et italiens, toutes religions confondues. Des noms, comme Moses Levy, Pierre Boucherle, Jules Lellouche et Antonio Corpora, forment le groupe des Quatre en 1936. En 1947, d’autres peintres vont s’ajouter au groupe comme Yahia Turki, Ammar Farhat, Jellal Ben Abdallah, Abdelaziz Gorgi, Ali Bellagha, Edgar Naccache, Zoubeir Turki… rompant avec les courants artistiques coloniaux et apportant des idées et des vues novatrices.
Sauveur rentrera ainsi dans un cercle d’intellectuels italo-tuniso-français grâce non seulement à sa passion pour la peinture, l’art, les couleurs et la joie de vivre, mais aussi parce qu’il réussit à s’échapper du ghetto sicilien, s’intégrant à la culture française. «C’est grâce à la langue française que j’ai pu intégrer et connaître ce beau monde», dira-t-il, un peu à la façon de Mario Scalesi, poète maudit sicilien de Tunisie qui loua la langue et la culture françaises comme vecteur pour la réussite et l’ascension sociale en Tunisie.
Sauveur fera aussi partie d’un mouvement d’intellectuels appelé «Les pieds nus». Il s’agissait en effet d’un tout petit groupe d’intellectuels tout bord et religion confondus, qui se réunissait en plein centre de la capitale, au Café de Paris à l’Avenue de France, marchant pieds nus, sans chaussures, une sorte de provocation et de protestation contre la société moderne de l’époque. Ces artistes refaisaient le monde autour d’une bière ou d’un verre de vin.
Sauveur continuera à travailler comme tailleur, métier qu’il adora, mais comme peintre aussi, vendant ses tableaux un peu à droite et un peu à gauche à des prix dérisoires. Il sera le tout petit du groupe des peintres italiens de l’Ecole de Tunis.
La petite retraite, que l’Ambassade de France lui donnait, ne suffisait pas trop aux dépenses de Sauveur, qui adorait acheter de tout et de n’importe quoi au souk du dimanche à Bouselsla : fleurs en plastiques horribles, vieux sofas défoncés, des chats, animaux rares, tissus, vieux pulls troués…
Sauveur, bon buveur de vin rosé, devait avoir sa bouteille sur sa table pour bien arroser son repas et accueillir ses amis. Il dira en sicilien «senza vinu u mangiari un mi scinni», sans le vin je ne peux pas avaler mon repas.
L’argent lui file entre les doigts et après avoir payé le loyer et être allé pour deux semaines consécutives au souk, il ne lui restera plus rien. Il décidera alors de se remettre à la peinture, activité qu’il n’avait jamais abandonnée complètement. Ses sujets préférés restaient toujours les portraits, les bouquets de fleurs, les nus…
Il est resté toujours très attaché à la Tunisie, pays qu’il n’a jamais voulu quitter. Ses amis étaient des siciliens, des juifs de Tunisie, quelques français, «des arabes» et tout le monde s’exprimait en français, sauf dans la rue du Maroc où Sauveur continuera à habiter et à parler la langue de ses aïeux, «une langue vulgaire» nous dira-t-il, mais toujours sa propre langue, le sicilien. Avec ses amis, toutes croyances confondues, le problème religieux ne se posait même pas, aucune tension entre ses amis juifs, musulmans ou bien chrétiens. Ils étaient très soudés, ils fêtaient tous ensemble Noël, ramadan, l’Aïd, la pâques juive… ils se chamaillaient, ils s’aimaient, ils s’insultaient, mais jamais le côté religieux n’a été abordé, jamais ! La religion fait partie de la sphère personnelle de tout individu et personne, nous dira-t-il, n’avait à l’époque le droit de demander quoi que ce soit. Nous étions tous des tunisiens ! Chaque vendredi, Sauveur allumait un cierge au prophète Mohamed et chaque dimanche à la Vierge Marie.
Sauveur est décédé à Tunis en 2017, dans la misère, comme la plupart des artistes, seul avec ses souvenirs et un amour disproportionné pour la Sicile et sa Tunisie natale. Il repose au cimetière du Borgel.